Table des matières de cette page:
1. Le système énergétique
actuel : basé sur les énergies non renouvelables
2. Les énergies fossiles
: raréfaction programmée et problèmes environnementaux
3. L’énergie nucléaire
: des problèmes environnementaux et d’acceptabilité
4. Le renouvelable : d’immenses
potentiels mais un développement difficile
5. La consommation énergétique
mondiale
6. Quel Futur pour l’énergie
?
1. Le système énergétique
actuel : basé sur les énergies non renouvelables
Chaque
année, l'humanité consomme 10.8 milliards de tonnes
d'équivalent pétrole (1)
, quantité contenue dans un cube d’environ 2.2 km d'arête.
Cela représente 1.5 tonnes par habitant ou 2 kW de puissance
continue (1 fer à repasser à chaque main, continuellement
allumé...).
(1) Une tonne équivalent
pétrole (TEP) correspond à l’énergie
dégagée par la combustion parfaite d’une tonne
de pétrole. 1TEP = 42 GJ = 11'700 kWh.
Le prix de l'énergie, qui est grosso modo
resté stable depuis quelques décennies, peut-être
qualifié de bas puisque le litre de mazout coûte, en
Europe, 2 fois moins cher que l'eau minérale, qui est une
ressource renouvelable, abondante et régionale....
Autre exemple, un bain de 100 litres coûte
environ 15 centimes pour le chauffage de l'eau contre 25 centimes
pour cette eau. Les habitants des pays du nord disposent donc très
facilement de toute l'énergie nécessaire et ne se
privent pas pour le superflu. Pour le citoyen peu au fait des réalités
des problèmes de l'énergie, cela peut sembler le signe
d'une très grande abondance en énergie, alors que
près de 85% des ressources utilisées ne sont pas renouvelables.
Cette première constatation doit être
relativisée par les inégalités profondes entre
la consommation des individus selon les continents. Ainsi, un américain
moyen va consommer 8 tonnes de mazout par année contre 0,3
pour le citoyen de certains pays d'Afrique ou d'Asie. Il s'agit
de moyenne et on se gardera ici de comparer la consommation d'énergie
des 5% les plus riches de la planète à celle des 25%
les plus pauvres, qui correspond au minimum vital. On estime à
2 milliards le nombre d'individus vivant sans électricité.
Les agents énergétiques se répartissent de
la façon suivante :
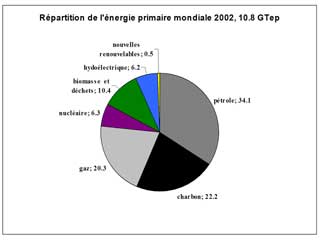
Energie primaire, total : 10’800 MTEP.
Valeurs 2002, d’après AIE (2004) (World Energy Outlook)
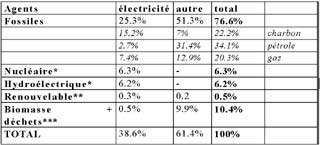
Energie primaire, total : 10’800 MTEP.
Valeurs 2002, d’après AIE (2004) (World Energy Outlook)
* la part de l'électricité
a été "valorisée", c'est à
dire ramenée à l'énergie primaire nécessaire
à la produire dans une centrale électrique thermique
classique. Le facteur multiplicatif est 3, ce qui correspond à
un rendement de conversion chaleur électricité de
~ 40% et de combustion de ~ 80%.
** géothermie, éolien,..
***la part de la biomasse, essentielle dans de nombreux pays du
sud, est souvent écartée des statistiques officielles
car celles ci ne prennent en compte que les énergies liées
à des flux financiers, aisément comptabilisés.
Ces chiffres amènent quelques
remarques :
• Les énergies fossiles fournissent
près de 80% de l'énergie mondiale
• Le nucléaire ne joue qu'un rôle
modeste dans l'approvisionnement énergétique mondial
• Pour le moment, l'hydroélectrique
est la seule ressource renouvelable qui contribue de façon
réelle aux besoins humains, la biomasse étant en grande
partie gérée comme une ressource non renouvelable
(problème de la désertification)
• Si on s’intéresse à
l’énergie finale (celle qui est consommée),
la part de l’électricité tombe à 20%,
à cause des pertes de production
2. Les énergies fossiles : raréfaction
programmée et problèmes environnementaux
Les valeurs des réserves
et des ressources en énergie non renouvelables doivent être
traitées avec beaucoup de prudence, elles peuvent varier
selon les sources pour des raisons objectives (désaccord
scientifique, problèmes de définition,…) ou
des raisons plus subjectives, liées par exemple à
des aspects géopolitiques. Il faut également bien
séparer ressources et réserves et prendre garde au
degré de fiabilité des chiffres.
Il faut tout d'abord distinguer ce que l'on appelle
les "ressources" et ce que l'on appelle les "réserves
prouvées". Les ressources sont les quantités
théoriques estimées à partir de considérations
physiques sans contrainte technique ni économique. Les réserves
prouvées sont les quantités repérées
avec une haute probabilité (90% ou plus) susceptibles d'être
techniquement et économiquement exploitées.
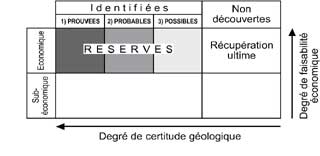
d’après Prof. Gorin, Université
Genève
Définition des réserves,
ensemble = ressource
1) prouvées : P90 : 90% de probabilité
2) probables : P50 : 50% de probabilité
3) possibles : P10 : 10% de probabilité
Depuis la révolution industrielle, on aurait consommé,
grosso modo, 1/5 des ressources totales pétrolières
(entre 1/4 et 1/6 selon les experts). Au milieu de ce siècle,
les derniers gisements importants de pétrole conventionnel
seront concentrés au Moyen Orient, ceux du gaz en Russie
et au Moyen Orient.
Il faudra alors exploiter le pétrole non
conventionnel (extra lourd, schistes et sables bitumineux,...),
mais à quel coût économique et écologique?
On imagine sans peine les tensions internationales que cela risque
de provoquer.
La situation du gaz naturel est analogue, quant
au charbon, il possède des réserves encore très
importantes.
La pollution urbaine
Il s'agit du fameux "smog" qui empoisonne
la vie des citadins en toutes saisons :
• en hiver, les inversions de température
associées aux émissions des chauffages et des véhicules
à moteur aboutissent à un haut niveau de pollution
de l'air (NOx, SO2, CO, imbrûlés,...)
• en été, le rayonnement solaire
associé à la chaleur et aux oxydes d'azote produits
par les véhicules à moteur provoque des taux élevés
d'ozone troposphérique.
Les problèmes soulevés par la pollution
de l'air des villes sont éminemment complexes et touchent
l'ensemble des disciplines : sciences de l'ingénieur, architecture,
urbanisme, aménagement du territoire, économie, sciences
humaines, droit, politique. Ils deviendront de plus en plus aigus
dans les métropoles du Sud, où se cumulent développement
anarchique des villes, techniques de transport anciennes et polluantes,
climat chaud et ensoleillé et manque de financements.
L'effet de serre
Il s'agit plus précisément de l'amplification
de l'effet de serre naturel, qui, en piégeant le rayonnement
infra rouge, augmente déjà la température du
globe de 30°C environ et la rend vivable. Certains gaz issus
des activités humaines et principalement de la production
ou de l'utilisation de l'énergie amplifient cet effet naturel.
Si la réalité de l'amplification de l'effet de serre
n'est pas remise en cause, son effet réel sur la température
du globe est lui très difficile à observer. D'où
le principe dit de précaution, qui veut que l'on limite les
émissions de gaz à effet de serre dès à
présent.
3. L’énergie nucléaire
: des problèmes environnementaux et d’acceptabilité
Ressources
Concernant les réserves en uranium, il faut
se montrer très prudent sur les chiffres pour les raisons
suivantes :
• Il s'agit de gisements très dilués
(< 1%), dont les conditions de formation sont mal cernées.
• L'uranium est une matière première
hautement stratégique et les données sur les réserves
sont souvent considérées comme secret militaire.
Les ressources en uranium ne sont pas un problème
avant le XXIIème siècle au rythme de leur utilisation
actuelle.
La filière nucléaire est caractérisée
par sa complexité et sa haute technicité.
La pollution radioactive
L'accident de Tchernobyl a clairement montré
que l'utilisation de l'énergie nucléaire, en l'état
des techniques, n'était pas exempte de conséquences
globales sur l'environnement.
Quels obstacles au nucléaire
aujourd'hui?
D’après l’article de D. Finon
dans livre Cuepe EES N° 2, plusieurs contraintes pèsent
sur le développement de l'énergie nucléaire
:
• Acceptabilité sociale. La spécificité
des risques nucléaires - risque d'accident de très
faible probabilité mais aux conséquences très
élevées, risque de gestion des déchets de vie
longue étalée sur une durée intergénérationnelle,
risque de prolifération militaire - rend difficile la formation
de préférence collective et impossible le consensus
scientifique.
• Contraintes économiques. Elles sont
au nombre de trois :
1. Inadéquation de la technologie nucléaire
avec l'organisation concurrentielle des industries électriques
: unités nucléaires non divisible (1 000 MW d'un coup)
et très gourmande en capital (peu de combustible), crainte
des incertitudes à moyen et long terme (risques réglementaires,
risques de fin de vie, risque de rejet social en cas d'accident
majeur dans le monde,..)
2. Concurrence des cycles combinés à
gaz (production d’électricité avec un cycle
fermé à turbine à vapeur et un cycle ouvert
à turbine à gaz de combustion du gaz naturel)
3. Contrainte de financement dans les pays émergents
: les organismes internationaux ont de la peine à trouver
les importants capitaux nécessaires, les acteurs locaux n'ont
pas la taille économique suffisante et préfèrent
des options plus progressives.
4. Le renouvelable : d’immenses potentiels
mais un développement difficile
L'homme n'a pas attendu la fin de
ce siècle pour se chauffer, se mouvoir, produire grâce
à l'énergie solaire. Elle a longtemps constitué
l'unique ressource énergétique de l'humanité,
mais la civilisation industrielle n'a pu s'accommoder d'une source
d'énergie abondante mais capricieuse, naturelle mais fugitive.
Pour bien appréhender le rôle qu'elles pourront jouer
dans le futur, on peut relever six points importants.
Study in depth: Spécificités
des énergies renouvelables (pdf) , Bernard
Lachal, Université de Genève
1. La part des énergies renouvelables
dans la couverture des besoins humains a atteint son minimum et
a maintenant tendance à croître.

2. L'utilisation énergétique
de la biomasse constitue encore le pilier des énergies
renouvelables, principalement au sud. Toutefois, l'homme a à
son égard un comportement essentiellement de prédateur
qui doit être radicalement modifié pour qu'elle mérite
véritablement son qualificatif de renouvelable". Exploitation
"raisonnable" de la forêt, développement
de cultures énergétiques efficaces et ne concurrençant
pas la production alimentaire sont quelques uns des défis
à relever pour que le potentiel important de cette filière
soit pleinement et durablement exploité, ce qui serait une
révolution dans les rapports que l'homme entretien avec la
nature.
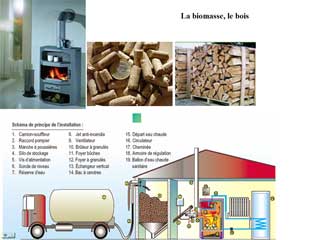
3. Les filières
très anciennes, datant de l'antiquité (hydraulique
et éolienne), ont pleinement bénéficié
d'avancés techniques (turbines, aéronautique,..) et
constituent encore des technologies sur lesquelles il faut compter.
Les moulins ont totalement disparu et la force de l'eau est utilisée
aujourd'hui pour produire de l'électricité qui peut
être facilement transportée et distribuée grâce
au développement du réseau électrique. Le taux
d'équipement de l'hydroélectricité est très
variable d'un continent à l'autre : très élevé
en Europe (80%), moyen en Amérique du Nord (50%) et faible
en Amérique latine, Afrique et Asie (<30%), qui possèdent
un potentiel énorme. L'impact sur l'environnement que peut
avoir de grands barrages, comme Assouan en Egypte ou le futur barrage
des 3 Gorges en Chine, peut être important; sans que cela
d'ailleurs soit une fatalité (voir l'utilisation du potentiel
hydraulique des pays de l'arc alpin par exemple). La mise en œuvre
d'installations plus petites (jusqu'aux microcentrales de quelques
kW) est nettement plus favorable de ce point de vue.
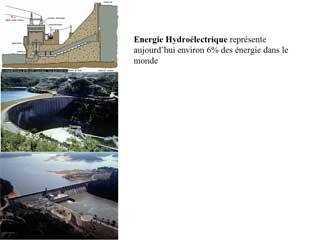
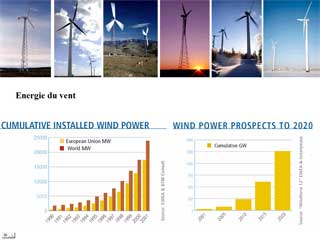
4. A plus long terme, seule
une transformation intensive issue directement du rayonnement solaire
a la capacité quantitative de se substituer aux énergies
fossiles, à condition que la demande en énergie se
stabilise grâce à une utilisation plus rationnelle.
Le rayonnement solaire constitue une ressource 10 000 fois supérieure
à la consommation mondiale d'énergie, répartie
assez régulièrement à la surface de la terre
quand on le compare aux autres ressources. L'espace nécessaire
aux transformateurs solaires n'est pas exagérément
important relativement aux autres transformateurs si on tient compte
de toute la chaîne, depuis l'extraction jusqu'au traitement
des déchets.
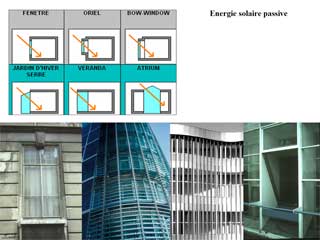
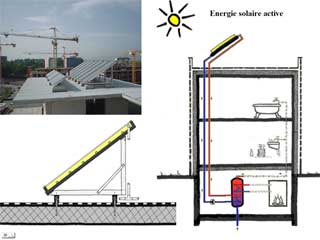
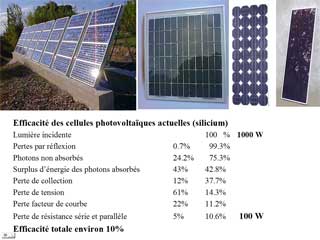
Les filières renouvelables les plus utilisées
aujourd'hui sont les plus extensives, et de plus elles sont liées
à d'autres cycles naturels fondamentaux (carbone et eau pour
les forêts et les grands barrages). Pour produire la même
quantité d'électricité que le barrage d’Assouan
(Haute vallée du Nil), il suffirait d'installer aujourd'hui
une centrale thermique solaire couvrant une surface d'environ 20
km² (soit une très faible portion de la retenue d'eau
actuelle), à des coûts économiques et environnementaux
certainement très inférieurs.
Les exploitations intensives (solaire mais aussi
éolienne) présentent donc des avantages indéniables
en permettant une exploitation de lieux inadaptés pour d'autres
activités (déserts, mers,..). Des différentes
filières possibles, le photovoltaïque semble être
le meilleur candidat à long terme. Il constitue également
la seule filière réellement nouvelle et en pleine
évolution, où le potentiel de nouveautés technologiques
est immense. Les possibilités d'un développement rapide
sont réelles mais soumises à des contraintes économiques
difficiles. Sous nos latitudes, la capacité de pénétration
de ces technologies est principalement limitée par la possibilité
de stocker l'électricité d'une saison sur l'autre.
La filière hydrogène est à ce titre pleine
d'avenir mais son développement est discuté car soumis
au développement de nouvelles infrastructures lourdes.
5. Il ne faut pas opposer
production centralisée et production décentralisée,
qui sont complémentaires. Un point de vue souvent rencontré
veut qu'on oppose ces deux possibilités. Ne vaut-il pas mieux
renoncer à de tels schémas, souvent purement idéologiques,
et saisir toutes les opportunités de développement
des énergies renouvelables: la première forme fournit
des kWh à un réseau tandis que la deuxième
fournit soit directement des prestations dans des zones isolées,
soit soulage le réseau existant.
On estime à près de 2 milliards le
nombre de personnes au monde non encore connectées à
un réseau électrique et la plupart ne le seront sans
doute pas dans l'immédiat. On peut couvrir quelques besoins
élémentaires de cette population (éclairage,
radio,..) par des minicentrales solaires décentralisées,
individuelles ou collectives : il s'agit d'un marché très
important aussi bien pour la population concernée et pour
les acteurs du photovoltaïque.
6. La poursuite du développement
des énergies renouvelables suppose une vision à long
terme et une action volontariste, comme le montre clairement
le succès de la filière "éolienne".
Un rôle critique est tenu par les pouvoirs
publiques et par les grandes sociétés énergétiques,
en pleines évolutions actuellement (mondialisation de l'économie,
affaiblissement du rôle de l'état, libéralisation
des marchés de l'électricité et du gaz,...).
Une attention particulière sera nécessaire pour que
la réglementation qui va être mise en place à
l'occasion de la libéralisation des marchés énergétiques
prenne en compte le nécessaire développement des énergies
renouvelables.
5. La consommation énergétique
mondiale
1) La consommation énergétique
actuelle : abondance apparente mais déséquilibres
profonds.
Chaque année, l'humanité consomme
environ 10 milliards de tonnes d'équivalent pétrole,
dont la répartition géographique est la suivante:
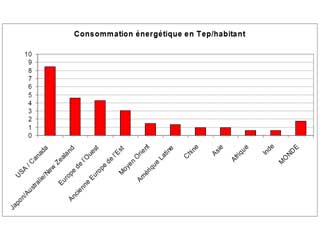
Consommation mondiale d’énergie,
par habitant et pour différentes régions (2000)
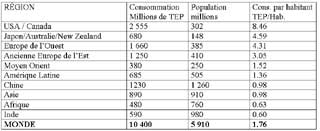
Consommation mondiale d’énergie,
par habitant et pour différentes régions (2000)
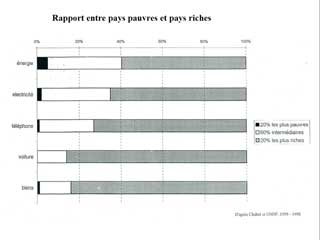
Rapport entre pays pauvres et pays riches
2) Les différents usages
de l’énergie : l’importance du domaine bâti
Dans les pays développés, on constate
une certaine tendance à l’égale répartition
entre les trois usages habituels de l’énergie : habitat/agriculture,
transports et industrie. Dans les autres pays, la répartition
varie fortement selon la structure sociale du pays, son taux d’urbanisation,
le type d’industrie,… En Suisse, la répartition
est la suivante :
Industrie/Services/Agriculture : 38%
Transport : 33%
Ménages : 29%.
Industrie
Les besoins énergétiques par unité
de marchandise produite diminuent avec le temps grâce à
l’amélioration des technologies et aux pressions environnementales.
L’énergie contenue dans les matériaux, objets,..
est appelée « énergie grise ».
Globalement, l’intensité énergétique
(quantité d’énergie par franc de richesse produite)
suit une évolution « en forme de cloche » avec
le temps : au début, l’industrialisation de base nécessite
beaucoup d’énergie pour la production des premières
richesses et on doit accroître fortement l’investissement
énergétique pour accroître la richesse ; passé
un cap, l’augmentation de la richesse fait appel de moins
en moins à de l’énergie et l’intensité
énergétique diminue. Une question essentielle est
la possibilité pour les pays non développés
ou en cours de développement d’éviter la première
phase très intensive en énergie pour accéder
directement à une faible intensité énergétique
(« leap frogging »).
Transport
Le secteur des transports est le secteur qui augmente
le plus vite, que ce soit les voitures individuelles, le transport
des marchandises en camion ou le transport aérien. Ainsi,
en Suisse, la contribution du transport est passée de 27%
en 1980 à 31% en 1996, cela correspond à un accroissement
relatif deux fois supérieur à celui de la consommation
énergétique totale.
Il faut souligner l’importance de l’aménagement
du territoire dans le choix des modes de transport des personnes,
comme le montre la figure ci après.
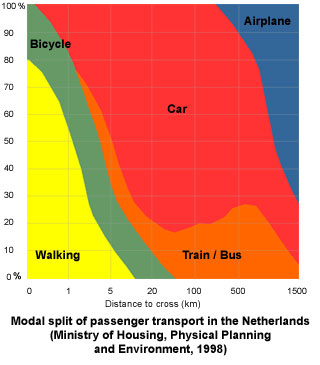
Par exemple, on constate sur ce graphique, valable
pour la Hollande, que pour les distances inférieures à
500 m, 20% des gens se déplacent en vélo, les autres
à pied. Pour des déplacements de plus de 3 km, la
majorité des personnes choisissent des modes utilisant de
l’énergie (train, bus, voiture et avion).
Bâtiments
Cinq points peuvent être relevés:
1. les besoins thermiques
des bâtiments représentent un enjeu important pour
l'utilisation rationnelle de l'énergie. Ainsi, à Genève,
la demande d’énergie thermique des bâtiments
(chauffage et eau chaude) représente :
• Plus que 50%
de la consommation énergétique du canton de Genève
• Environ 42%
de l’énergie totale consommée en Suisse
• Environ 33% de
la consommation mondiale
2. l'évolution de la consommation
énergétique liée est caractérisée
par une relative stabilité en Suisse comme dans les pays
voisins, malgré une forte augmentation de surface.
3. de nouveaux besoins
apparaissent ou vont apparaître dans les pays méditerranéens
(encore peu chauffés) ou du sud (eau chaude sanitaire).
4. les possibilités d'action
pour maîtriser l'usage de l'énergie sont nombreuses,
mais longues à mettre en place.
5. Le cas de la
climatisation est beaucoup plus complexe mais préoccupant.
Study in depth: Les
besoins d'énergie thermiques des bâtiments (pdf)
Bernard Lachal, Université de Genève
6. Quel Futur pour l’énergie ?
Les scénarios énergétiques
à long terme (2050 – 2100) sont sujets à de
nombreuses études. Rappelons qu’il s’agit d’exercices
de prospective, qui n’ont pas pour but de prédire l’avenir
mais d’imaginer et d’explorer les futurs possibles.
La différence principale entre les scénarios
que l’on peut trouver dans la littérature réside
dans la consommation totale d’énergie consommée.
Celle-ci peut varier du simple au double en 2050 et du simple au
quadruple en 2100. Les scénarios à basse consommation
se basent sur des politiques exigeantes, les scénarios à
haute consommation sont souvent des scénarios dits de «
laissez faire » (« business as usual »).
La possibilité de réellement limiter
la consommation énergétique est un sujet d’intenses
controverses ; tout le monde s’accorde à penser que
ceci est techniquement possible et souvent économiquement
rentable. Le conservatisme et la résistance au changement
sont les facteurs explicatifs souvent donnés. Ce qui fait
dire à certains que seule une crise importante pourrait faire
bouger les mentalités.
Dans une perspective 2050 et malgré leur
différence, les divers scénarios s’accordent
toutefois sur certains points:
• Les énergies fossiles (pétrole,
gaz et charbon) continueront à être beaucoup employées,
la quantité totale utilisée est évidemment
minimum dans les scénarios économes en énergie
• La part du nucléaire ne dépassera
pas les 15%, sa contribution étant le plus souvent imaginée
identique à la présente (5 – 10%)
• La contribution des énergies renouvelables
varie fortement (20 à 50%), elle est la plus forte dans les
scénarios à basse consommation
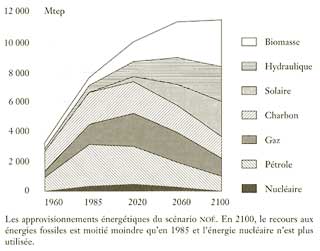
Exemple de scénario très volontariste,
où la consommation énergétique est contenue
par des actions vigoureuses d’économie d’énergie
(baisse dans les pays du Nord, augmentation dans ceux du Sud pour
arriver à un certain rapprochement) ; on voit la part importante
que peut prendre dans ces conditions les énergies renouvelables.
Scénario NOE, de B. Dessus, voir Exemple de comparaison de
3 scénarios : article BL sur scénarios.
Study in depth: Le
système énergétque mondial, 3 scénarios
long terme (pdf) Bernard Lachal, Université
de Genève
En conclusion, la résolution des problèmes énergétiques
sera d’autant moins difficile que la consommation énergétique
sera limitée. Vu l’importance des quantités
d’énergie utilisée pour la construction et l’utilisation
des bâtiments, il est dès lors impératif d’intégrer
le plus possible les impératifs d’économie d’énergie,
que ce soit pour le neuf ou la rénovation. Le rôle
de l’architecte est dans ce cadre prépondérant.
|
![]()